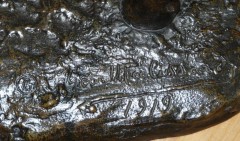Juin 13, 2011 | • La valeur d'un bronze ancien
Il y a quelques années (20 ?), une affaire de faux passeport d’un homme politique a donné lieu à l’apparition dans les médias d’une insupportable expression utilisée à tout bout de champ et de façon inappropriée : « vrai-faux ». Désormais, on n’entend plus faux, mais « vrai-faux » en permanence : un « vrai-faux » alibi, un « vrai-faux » document, une « vraie-fausse » information… Cela ne veut rien dire.
Ceci étant dit, je vais vous parler ici d’un faux faux bronze !
Un ami a acheté, lors d’une vente aux enchères, un taureau couché de Rosa Bonheur. Il me l’a montré car il était très sceptique sur l’authenticité de cette pièce.

Effectivement, plusieurs éléments étaient très troublants : d’abord une patine grisâtre curieuse, comme si la pièce était en… zinc ; ensuite, une ciselure très sommaire ; et encore, le dessous du socle gris foncé uni ayant une allure trop neuve ; enfin et surtout des dimensions anormales, puisque la longueur de cette pièce, telle que mentionnée dans les livres, est de 27 cm alors que le bronze que nous avions entre les mains mesurait 29 cm. Un écart de 2 cm soit près de 10% est trop important pour qu’il s’agisse d’une erreur de mesure. La signature – Rosa B – était en revanche bonne.

Cet ami a exposé ces faits au commissaire-priseur qui, honnête, lui a immédiatement proposé de reprendre la pièce et de le rembourser, puisque le bronze était annoncé comme « Bronze de Rosa Bonheur » et non « Bronze d’après Rosa Bonheur ». Il a toutefois marqué son étonnement puisque ce bronze venait d’une succession un peu ancienne : « cette pièce n’est peut-être pas une fonte d’époque, mais elle date sans doute des années 1950 » a-t-il fait remarquer.

Nous avons donc commencé par nettoyer soigneusement ce bronze, très encrassé. Première découverte : les détails sont bien présents, ce qui se voit sur la queue, l’œil du taureau, le chanfrein.
Deuxième opération : cirage. Un petit tour à la fonderie nous a permis de chauffer légèrement le bronze avant de le cirer, ce qui fait davantage pénétrer la cire. Et là, la patine est devenue superbe, tout à fait identique à un autre taureau de Rosa Bonheur – debout celui-ci – que possède également cet ami. On était alors en présence d’un beau bronze… sauf qu’il mesurait 2 cm de trop !

C’est le livre de référence « Les Bronzes du XIXème » de Pierre Kjellberg qui a apporté la clé de ce mystère, à l’article Rosa Bonheur : « Des sujets différents, certains tirés par d’autres fondeurs que Peyrol, ont été présentés en 1973 à la galerie des Arts décoratifs, à Lausanne, dans le cadre de l’exposition Les Animaliers du XIXème siècle. Il s’agit de Bélier couché 9,5 x 22,5 cm […], Taureau beuglant 15 x 22 cm, Taureau couché 15 x 29 cm ».
Et voilà, nous étions en présence d’une de ces pièces, ou au moins identique à l’une d’elles.

A peine cet article terminé, je découvre qu’à Boulogne/mer, le 25 juin prochain (2011 donc), sera mis en vente un Taureau couché de Rosa Bonheur, fondu par Peyrol, son beau-frère, donc au-dessus de tout soupçon de copie ou surmoulage – les bronzes de Rosa et Isidore Bonheur fondus par Peyrol sont les plus recherchés – et dont la longueur est annoncée comme faisant 28,5 cm !
Voici qui illustre encore une fois la très grande difficulté à s’y retrouver entre les vrais et les faux bronzes, les exemplaires authentiques, les fontes d’atelier, les bronzes « d’après.. », les surmoulages, les fontes tardives… Et finalement, comme dans d’autres domaines, il n’y a qu’en « pratiquant » énormément, autrement dit en observant de très très nombreuses pièces, que l’on peut se faire une idée de l’authenticité d’une pièce.
Et cet ami a conservé son taureau couché, ce qui lui a permis de posséder les 3 taureaux que Rosa Bonheur a réalisés : Taureau marchant, Taureau beuglant et notre Taureau couché.
Mai 9, 2011 | • La valeur d'un bronze ancien
Mme Guillemette de Q. m’a adressé de belles photos d’un bronze charmant signé Emmanuel Frémiet. Elle s’interroge sur l’étonnant harnachement du cheval et la présence d’un chat sur le dos de celui-ci.
Les dimensions de ce bronze sont les suivantes : 21,5 cm de large x 22 cm de haut x 6 cm de profondeur. Elle a remarqué un tout petit chiffre gravé sur la terrasse : « 45 ».

J’ai déjà parlé sur ce site d’Emmanuel Frémiet (1824-1910), qui est selon moi le plus talentueux, le plus prolifique, le plus grand sculpteur animalier. Son oeuvre est d’une incroyable richesse et ne se limite d’ailleurs pas aux animaux. Il a réalisé des œuvres aussi diverses et pittoresques que « Canards se disputant un rat », « Pan et les oursons », « George Washington », « Bertrand Du Guesclin à cheval », « Orang Outan et sauvage de Bornéo », « Gorille enlevant une femme », « Éléphant pris au piège »… La liste est interminable !
Pour vous en convaincre, cherchez « Frémiet » (photos) sur internet.

Il existe peu d’ouvrages sur ce génie ultra-perfectionniste. Je recommande tout particulièrement « La main et le multiple » édité par le Musée des Beaux-Arts de Dijon et le Musée de Grenoble, mais hélas les photos sont en noir et blanc et, s’il est d’une très grande richesse, cet ouvrage pâtit un peu d’une mise en page aride.
Revenons à notre petit cheval.
Son titre exact est donc « Cheval de saltimbanque 2ème version ». Selon le livre précité, Frémiet aurait été séduit par un petit cheval de foire. Il « le pista jusqu’à Senlis pour finalement l’acheter à son propriétaire avec tout son harnachement et le ramener à son atelier à deux heures du matin« .
Dans la 1ère version, créée en 1849, le cheval portait sur son dos une chouette. Il fut exposé au Salon de 1859 mais fut détruit par un malveillant, dans l’atelier de Frémiet boulevard de Longchamp. On imagine la tristesse du sculpteur face ce geste imbécile. Heureusement, il en avait gardé une esquisse et put le refaire, cette deuxième version étant légèrement modifiée : le chat a remplacé la chouette et la queue du cheval est coupée.
Sur la selle, on distingue deux marionnettes, la tête sous un bonnet et les jambes faites de petits morceaux de bois fin. Pour bien apprécier la finesse des détails, il faut réaliser que le chat mesure en tout 5 cm de haut !

Voici un extrait du commentaire fait par Baudelaire sur la version n°1 présentée au Salon de 1859 :
« Si M. Frémiet me dit que je n’ai pas le droit de scruter les intentions et de parler de ce que je n’ai pas vu, je me rabattrai humblement sur son Cheval de saltimbanque. Pris en lui-même, le petit cheval est charmant ; son épaisse crinière, son mufle carré, son air spirituel, sa croupe avalée, ses petites jambes solides et grêles à la fois, tout le désigne comme un de ces humbles animaux qui ont de la race. Ce hibou, perché sur son dos, m’inquiète (car je suppose que je n’ai pas lu le livret), et je me demande pourquoi l’oiseau de Minerve est posé sur la création de Neptune ? Mais j’aperçois les marionnettes accrochées à la selle. L’idée de sagesse représentée par le hibou m’entraîne à croire que les marionnettes figurent les frivolités du monde. Reste à expliquer l’utilité du cheval qui, dans le langage apocalyptique, peut fort bien symboliser l’intelligence, la volonté, la vie. ».

Frémiet a sculpté un très grand nombre de chevaux, mais à la différence d’un Pierre-Jules Mêne ou d’un Isidore Bonheur, qui les représentaient volontiers en liberté ou au moins non montés, la plupart de ceux de Frémiet servent de monture, que ce soit à un cavalier romain ou gaulois, à Jeanne d’Arc, Napoléon, au terrible Tamerlan (sous sa monture, s’empile des crânes humains), à Bolivar, Saint Georges, François Ier, etc, etc. Ces chevaux sont souvent majestueux, bien campés – attitude que l’on retrouve dans le cheval de Saltimbanque – puissants. On devine l’effort du cavalier pour les retenir. Détail amusant, on retrouve sur plusieurs pièces cette terrasse en pente que l’on voit ici et qui surélève le train avant de l’animal.

C’est une très belle pièce, rare. Le Musée de Dijon en possède un exemplaire.
Je n’ai vu ce cheval de Saltimbanque qu’une seule fois en vente, il n’y a pas très longtemps, et il a été adjugé 1500 Euros frais compris, ce qui est selon moi inférieur à sa valeur. Une aussi belle pièce, surtout avec une belle patine comme cet exemplaire, devrait partir à 2500 Euros au moins.
Vous avez un bronze animalier et vous voulez en connaître la valeur ? Envoyez-moi des photos très nettes de l’ensemble, de la signature, de l’éventuelle marque du fondeur, du dessous du socle à : damiencolcombet@free.fr
Mar 11, 2011 | • La valeur d'un bronze ancien
Monsieur O. m’a envoyé il y a déjà plusieurs semaines – je reçois de très nombreuses demandes d’avis sur des bronzes et j’y réponds toujours, mais je prends parfois du retard – d’excellentes photos d’une pièce signée Moigniez. Je souligne la qualité des clichés car il est difficile de donner un avis sur photos, mais si elle sont de mauvaises qualités, floues, cela devient impossible.

Jules Moigniez est né à Senlis en 1835 et mort à Saint-Martin-du-Tertre (Seine-et-Oise) en 1894. Son père était doreur de métaux. Jules fut élève de Paul Comolera (1818-1897), grand sculpteur spécialisé dans les oiseaux. On voit souvent, de Comolera, une jolie petite oeuvre quoique un peu triste : un moineau mort couché sur le dos.
Moigniez exposa sa première scène lors de l’Exposition universelle de 1855 (à 20 ans !) : « Chien braque arrêtant un faisan« . Il exposa ensuite régulièrement au Salon, de 1859 à 1892. Il connût un très grand succès, tant en France qu’en Angleterre et même aux Etats-Unis, y exportant nombre de ses œuvres. Face au succès de son fils, son père créa spécialement une fonderie pour lui ; une grande partie des œuvres furent donc fondues « en famille ».
Très malade, Jules Moigniez s’est suicidé en 1894.

Dans le « Dictionnaire illustré des sculpteurs animaliers » du Dr.Hachet (Editions Argus Valentines) comme dans « Les bronzes du XIXème siècle » de P.Kjellberg (Editions de l’Amateur), il est dit que les appréciations sur ses œuvres sont assez contrastées : certains admirent le très grand travail de ciselure, tandis que d’autres considèrent qu’il est poussé à l’excès.
Est-ce pour cela que Moigniez est sensiblement moins coté que d’autres illustres sculpteurs animaliers du XIXème siècle ? Par seulement, me semble-t-il. je trouve qu’il y a chez beaucoup d’œuvres de Moigniez un manque de vie, un aspect trop souvent figé, voire même parfois un peu caricatural. Ce n’est pas vrai de tous ses bronzes, mais un certain nombre, en particulier les chiens et les chevaux, ont une allure raide et manquent de naturel. D’une certaine façon, les bronzes de Moigniez n’ont pas la force de ceux de Barye ni l’exactitude de ceux de Mène.
Revenons au bronze de Monsieur O. Il représente donc une scène d’affrontement entre une petite belette et un coq faisan. Difficile de dire qui a attaqué l’autre car le volatile a sûrement des comptes à régler avec le petit carnivore qui vole les œufs et sait se montrer très féroce, mais la belette, malgré sa petite taille, pourrait bien être tentée de sauter au cou de l’oiseau et de le saigner !

La signature en écriture cursive est bien caractéristique de Moigniez. Le dessous du socle révèle un montage un peu hétéroclite fait d’écrous et de clavettes, tout à fait ancien.

Le bronze est ici posé sur une pendule tout à fait neutre et dont on voit bien qu’elle est destinée à ne pas nuire au sujet qui la surplombe. Je ne sais qui produisait les pendules de ce type, mais je les ai souvent vues servant ainsi de socle aux bronzes. Cette semaine encore, j’en ai vu une identique supportant un joli petit bronze de Delabrierre.
Le modèle initial du faisan et de la belette a été sculpté en 1864. Moigniez avait donc 29 ans. L’artiste était visiblement tout à fait confirmé à cette date, et le travail du plumage le prouve parfaitement. La belette a pourtant une drôle d’allure, ressemblant un peu à un petit ours. On note aussi l’allure un peu trop « romantique » du faisan, une patte en avant, l’autre en arrière, et la tête inclinée.

Bref, il s’agit d’une très belle pièce, parfaitement ciselée et possédant une belle patine mais elle illustre aussi les critiques – peut-être un peu sévères… – qui peuvent être faites à Moigniez. De plus, le thème du faisan, pratiqué par presque tous les sculpteurs du XIXème, je ne sais pourquoi, est plutôt passé de mode. Perdrix et cailles sont également un peu démodées, mais certaines jolies pièces sont encore appréciées.

Quelle valeur pour ce grand bronze, dont on donne les dimensions suivantes : 33 cm (long) x 15 cm (prof) x 35 cm (haut) ?
J’ai noté qu’un exemplaire proche, un faisan sur un petit tertre, mais probablement plus petit, était mis en vente à Valence le 17 mars. Interrogé, le commissaire-priseur l’estime à 300 ou 400 Euros.
Par ailleurs, voici quelques résultats de ventes aux enchères pour la même pièce exactement que celle de Monsieur O. :
– Tajan – Mars 2009 : estimé 3500 à 4000 Euros et invendu, ce qui n’est pas étonnant car largement surévalué.
– Liège (Belgique) – Décembre 2000 : adjugé à 1400 Euros
– Saint-Etienne – 1999 : adjugé 1200 Euros
– Toulouse – 1998 : adjugé 2100 Euros
Compte tenu de mes remarques ci-dessus sur les qualités et les « défauts » de ce bronze, il me semble qu’une estimation juste tournerait aujourd’hui autour de 1000 Euros, ou, pour être moins précis, dans une fourchette de 800 à 1200 Euros selon le lieu et le thème de la vente. Il me semble qu’il serait plus apprécié sans la pendule.
Merci à notre internaute de nous avoir montré cette jolie pièce et encore merci pour la qualité des photos.
Fév 20, 2011 | • La valeur d'un bronze ancien
Voici une petite anecdote illustrant la difficulté qu’il y a à identifier les « vrais » bronzes des « faux » bronzes.
Il y a quelques semaines, me promenant dans les boutiques des antiquaires, je repère deux bronzes : l’un représente une grande chienne de meute, est signée Mêne et présente une patine dorée. L’autre est une vache allaitant son veau, est également signé Mêne et possède une très belle patine marron foncée.
J’étais certain de la qualité de la chienne, d’une grande finesse (le moindre ongle était parfaitement ciselé). Un examen du dessous du socle montrait des écrous anciens, rouillés et irréguliers. De plus, les patines dorées n’étant plus du tout à la mode, il était certain qu’une fonte ou une copie récente aurait présenté une patine foncée.
Un examen attentif de la vache montrait également une très bonne ciselure et des détails très soignés. Bien entendu, l’antiquaire m’a expliqué que cette pièce valait beaucoup plus que le prix affiché (c’est un argument qui m’a toujours laissé sans voix, n’ayant aucun sens) et que plusieurs personnes étaient très intéressées (forcément…). Je dois dire que j’étais très tenté, mais un vague pressentiment me faisait hésiter. J’ai donc décidé de procéder à un examen extrêmement attentif de la pièce, sous la lumière. J’ai alors repéré deux sabots mal fendus, alors que les bronzes de Mêne et Frémiet sont toujours impeccables, et le ventre de la vache était un peu trop lisse. Nouvel examen jusqu’à découvrir 3 minuscules lettres sur le socle, cette signature étant la marque d’une fonderie contemporaine. La pièce était bien une reproduction, de très grande qualité mais très récente. Cette vache et son veau est d’ailleurs présentée sur le site internet de la fonderie.
Pour m’amuser, j’ai demandé à l’antiquaire, qui n’avait pas vu que j’avais repéré la marque de la fonderie, s’il pouvait garantir par écrit l’authenticité de ce bronze. il m’a répondu qu’il pouvait simplement mentionner : « Porte la signature PJMêne »…
Quels enseignements tirer de cette anecdote ?
En premier lieu que l’on peut toujours faire de bonnes affaires, la chienne saintongeoise, de Mêne, n’était pas chère.
D’autre part, évidemment, qu’il est extrêmement difficile de distinguer un « faux » bronze, si l’on peut appeler ainsi une reproduction récente, d’un « vrai », qui est soit une reproduction ancienne, soit un bronze du vivant de l’artiste. Il est certain que la notion de vrai et faux est toute relative, puisqu’elle se réfère essentiellement au décret du 3 mars 1981, qui prévoit en son article 9 : « Tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d’une oeuvre d’art originale au sens de l’article 71 de l’annexe III du code général des impôts, exécuté postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret, doit porter de manière visible et indélébile la mention « reproduction ».
Si l’on fait une lecture littérale de ce décret, un bronze de Barye fondu courant 1980 n’a pas besoin de porter la mention « reproduction » et peut donc passer pour un bronze ancien, tandis que le même bronze fondu fin 1981 doit porter cette mention, ce qui, lorsqu’il est présenté en salle des ventes ou chez un antiquaire, le prive d’une grande partie de sa valeur, alors que le processus de fabrication est le même.
Pourquoi la vache ne portait-elle pas la mention « reproduction » ? Soit parce qu’elle a été fondue avant 1981, soit, plus probablement, parce que cette marque a été masquée, ce qui est facile à faire.
Bref, on comprend que, comme pour un meuble ou un tableau, il n’y a finalement que l’expérience, la connaissance acquise en étudiant des centaines de pièces, qui peut permettre de distinguer une bonne pièce d’une mauvaise.
Enfin, une dernière leçon à retenir de cette affaire : si l’on veut s’abstenir de tout risque lors de l’achat d’un bronze ancien, il faut soit se faire aider d’un expert – mais on n’en a pas toujours sous la main ! – soit privilégier les galeries spécialisées, comme, à Paris, la galerie Tourbillon au rez-de-chaussée du Louvre des antiquaires (M° Palais-Royal Musée du Louvre) ou bien L’Univers du Bronze, rue de Penthièvre.
Jan 22, 2011 | • La valeur d'un bronze ancien
Madame Isabelle C. de Paris m’a envoyé de nombreuses photos d’un grand bronze qu’elle appelle « Le Maréchal Joffre », signé Malissard, et demande un avis sur cette belle pièce.

Georges Malissard est né en 1877 à Anzin et mort en 1942 à Neuilly-sur-Seine. Malgré son grand talent, il est un peu oublié de nos jours. C’est dans le remarquable « Dictionnaire illustré des sculpteurs animaliers » du Dr. Hachet (2 tomes – Argus Valentines) que j’ai trouvé le plus d’informations sur cet artiste, et plus précisément sur ce bronze.

Malissard était destiné, par ses origines, à une carrière d’industriel mais sa passion pour l’équitation, les chevaux et la sculpture en décidera autrement. Remarqué par l’architecte Constant, il est présenté à Frémiet et devient sculpteur, spécialisé dans les scènes équestres.
Il connaît alors un grand succès, tant auprès des propriétaires de chevaux dont il réalise le portrait, que du grand public. Avant la guerre, il réalise le portrait de plusieurs chevaux de Guillaume II. Après l’Armistice, l’Etat lui commande une statue des maréchaux vainqueurs : Foch, Pétain et Lyautey.

Malissard savait modeler d’autres sujets que les chevaux : lynx, éléphant d’Asie, chevreuils, sangliers, etc.
Le bronze de Madame C. est bien la réduction de la statue du Maréchal Foch – et non Joffre comme elle le pense – installée à Cassel et inaugurée le 6 juillet 1928 en présence du Maréchal lui-même et du Président Poincarré. Foch se dira à cette occasion heureux de n’avoir point été présenté avec une allure trop martiale mais dans une attitude simple. J’ai relevé que Tarbes, ville natale du Maréchal, possédait également une grande statue de Foch, mais j’en ignore l’auteur.
La plupart des bronzes de Malissard ont été fondus par le très grand Valsuani, mais ce n’est pas le cas de la pièce de notre internaute.

Observons de plus près ce grand bronze (45 cm de long et 47 cm de haut) : Isabelle C. nous dit l’avoir acheté couvert de poussière et l’avoir nettoyé comme il se doit à l’eau chaude, avec une petite brosse douce et du savon. Il était si sale qu’elle craignait, en voyant l’eau noire s’écouler, d’enlever la patine. En réalité, si l’on ne gratte pas un bronze avec du métal ou un objet dur, il n’y a pas de risques de l’abîmer. Le bronze a ensuite été ciré puis frotté et il a retrouvé un lustre que sa propriétaire n’imaginait pas. Elle a enlevé le marbre sur lequel le socle a été vissé et elle a bien fait, car cela allège l’ensemble.
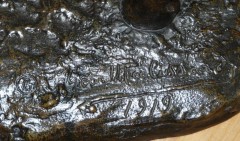
Cette scène est très simple par endroit (la croupe du cheval, le manteau du maréchal) et très détaillée à d’autres (la tête du cavalier et celle de sa monture, le képi, la poitrine du Maréchal et ses décorations). On relève les étuis des pistolets devant la selle et bien sûr le bâton étoilé de Ferdinand Foch.
L’enrênement est bien étudié. Un spécialiste m’a donné les explications du mors, que les cavaliers connaissent sûrement tous : il s’agit d’un mors de filet et d’un mors de bride. Le mors de filet est le plus doux, le plus classique, utilisé dans les conditions ordinaires, mais il est ici doublé d’un mors de bride, système qui permet de parfaitement « tenir » le cheval – en l’occurrence « Bengali », la monture préférée de Foch – même sur le front où les bombardements avaient sûrement de quoi effrayer un cheval. Celui-ci, représenté « au repos, oreilles tendues en avant, donne l’impression d’être attentif au bruit de la canonnade au loin » (Dr. Hachet). Avec ce mors, une gourmette – que l’on voit bien sur le bronze – passe sous la mâchoire inférieure du cheval et le pince fortement si le cavalier tire sur les rênes. En expert, Malissard n’a pas manqué de reproduire exactement la façon de tenir les rênes d’un tel « système » et l’on voit ainsi l’une des rênes passer entre l’annulaire et l’auriculaire du cavalier.

Sur le site internet suivant, on trouve une carte postale de l’entrée de Foch à Metz en 1918, incroyablement semblable à la scène représentée en bronze : http://www.notrefamille.com/cartes-postales-photos/cartes…
Qui sait si Malissard ne s’en est pas inspiré ?
Isabelle C. regrette que les rênes ne soient plus présentes que d’un côté et se demande s’il ne faudrait pas les convertir en rênes simples mais des deux côtés. Ce serait une erreur. Il faut simplement refaire les rênes manquantes. Elle trouvera très difficilement un mince ruban de bronze de 2 ou 3 mm de large et je lui conseille plutôt de le faire faire par une fonderie, qui écrasera au marteau une baguette de bronze de soudure puis la patinera, ce qui sera parfait.
La valeur de ce bronze pâtit du fait que les scènes de ce genre sont passées de mode, Foch n’évoquant peut-être plus grand chose, hélas, pour beaucoup de monde.
Meissonier a réalisé de nombreuses scène de ce genre et l’une d’elles est visible à l’entrée du mess de St-Augustin à Paris ; je ne me souviens plus quel officier est représenté.

J’ai noté quelques résultats plus ou moins anciens de vente pour ce bronze :
– 15 décembre 2010 à Paris : 1 740 Euros frais compris
– 19 septembre 2007 à Stuttgard : 2 100 Euros hors frais
– 21 octobre 2001 à Senlis : 1 665 Euros
– 13 juin 1999 à Lille : 4 264 Euros
La beauté de la scène, la belle réalisation, la patine devraient donner à ce bronze une valeur de l’ordre de 3000 Euros environ. Toutefois, il faut reconnaître que le sujet peu à la mode conduit à estimer le prix de vente de cette pièce aux alentours de 1800 Euros à 2 000 Euros
Vous avez un bronze animalier dont vous souhaitez connaître l’histoire et la valeur ? Envoyez des photos très nettes de l’ensemble, de la signature, de l’éventuelle marque de fondeur et du dessous du socle à cette adresse : damiencolcombet@free.fr, et je vous répondrai.
Oct 11, 2010 | • La valeur d'un bronze ancien
Voici une très belle lionne du grand Antoine-Louis Barye, dont les photos, très nettes, sont envoyées par Monsieur Marcel P. Notre internaute précise que ce bronze est dans sa famille depuis les années 50 et donne des dimensions très précises de la pièce.

Il s’agit de la « Lionne du Sénégal« . Plus que pour toute autre pièce, cette précision géographique a une grande importance. En effet, le sculpteur a créé un autre sujet presque identique, s’appelant « La Lionne d’Algérie« . Les deux font exactement la même hauteur et à première vue, il est impossible de les distinguer l’une de l’autre. MM.Richarme et Poletti mentionnent, dans leur « Catalogue raisonné des sculptures de Barye » (Gallimard) une lettre du sculpteur au collectionneur Alfred Bruyas le 19 décembre 1873, où l’artiste donne comme éléments distinctifs la tête et la queue : la Lionne d’Algérie tourne légèrement la tête vers la droite et avance la patte avant gauche, tandis que la Lionne du Sénégal tourne un peu la tête vers la gauche et ses pattes avant sont au même niveau.

J’ai plusieurs fois parlé sur ce site d’Antoine-Louis Barye (1795-1875) et je ne vais pas recommencer. Mais aux plus curieux, qui veulent tout savoir de ce très grand artiste, je recommande la lecture de « Monsieur Barye » de Michel Poletti (Editions Acatos – Nov 2002 – 322 p.).

La Lionne du Sénégal a été créée vers 1857 et les fontes posthume de Barbedienne sont nombreuses. C’est une pièce assez simple, statique, dont les détails, en particulier au niveau des yeux et des griffes, ne sont pas très marqués, mais elle possède un charme particulier, sans doute dû au modelé très apparent des muscles et à l’allure altière du fauve. Sa simplicité aurait pu lui donner une vocation de modèle pour de nombreuses copies et surmoulages, mais curieusement ce n’est pas vraiment le cas. En l’occurrence, l’authenticité semble avérée, d’autant plus que les dimensions communiquées sont bien celles mentionnées dans le Catalogue raisonné : 270 mm de long dont 227 mm pour le socle, 8 cm de profondeur et 200 mm de haut.

Le bronze de Monsieur P. porte la marque du fondeur Barbedienne mais le libellé permet de dater un peu la pièce : « F.Barbedienne Fondeur » a été utilisé au XIXème siècle et au tout début du XXème avant d’être remplacé par « F.Barbedienne Fondeur Paris ».

La « Lionne du Sénégal », comme celle d’Algérie d’ailleurs, est une pièce assez recherchée, ce qui explique des estimations plutôt élevées. Voici quelques résultats de vente aux enchères :
– Artcurial (Paris) le 22 juin 2009 : estimée 2000 à 3000 Euros, elle a été adjugée à 6120 Euros frais compris (soit environ 5000 Euros hors frais)
– Estimée 8000 Euros en novembre 2008 à St-Germain-en-Laye, elle n’a pas été vendue (estimation manifestement trop élevée).
– A New York (Clarke), le 28 mars 2010, estimée entre 2000 et 3000 dollars, elle a été adjugée 2820 Dollars.
Il me semble qu’une juste estimation pour cette belle lionne tournerait autour de 4000 Euros. Celle vendue chez Artcurial devait avoir une patine ou une ciselure remarquable, ou bien… il y avait LE collectionneur que tout vendeur espère et qui voulait précisément cette pièce !

Vous possédez un bronze animalier et vous souhaitez en connaître l’histoire et la valeur ? Envoyez-moi (damiencolcombet@free.fr) des photos très nettes de l’ensemble de la pièce, de la signature, de la marque éventuelle du fondeur et du dessous du socle, ainsi que les dimensions précises.