Winston Churchill (1874 – 1965) accomplit une tournée en Afrique de l’Est à l’automne 1907, alors qu’il était tout jeune sous-secrétaire d’Etat aux Colonies. A ceux qui aiment cette région (Somalie, Kenya, Tanzanie, Mozambique et autres, qui ne portaient pas ces noms-là à l’époque), je recommande la lecture du très intéressant petit livre relatant cette aventure.
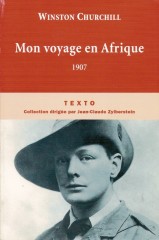
On est avant tout frappé de la maturité de ce voyageur de 33 ans, capable de mettre les événements et les pays en perspective, de porter un jugement intelligent et de prendre beaucoup de recul sur ce qu’il voit.
Churchill fait preuve d’un certain humour anglais, dans le style d’ailleurs de Gerald Durrell. Enfin, son style est très agréable. Pour mémoire, Churchill reçut le prix Nobel de littérature en 1953 pour l’ensemble de son oeuvre.
Le livre étonne également par la liberté de ton vis-à-vis du colonialisme et le respect des Africains, ce qui ne devait pas être si courant au début du XXème siècle.
Voici quelques extraits.
En premier lieu, un passage amusant :
« Si vous tombez à l’improviste, sans arme, sur six ou sept lions, tout ce que vous avez à faire – selon les informations que j’ai reçues – c’est de leur parler fermement et ils vont s’enfuir, surtout si vous leur jetez quelques pierres pour accélérer le mouvement. Les plus hautes autorités recommandent toutes cette procédure ».
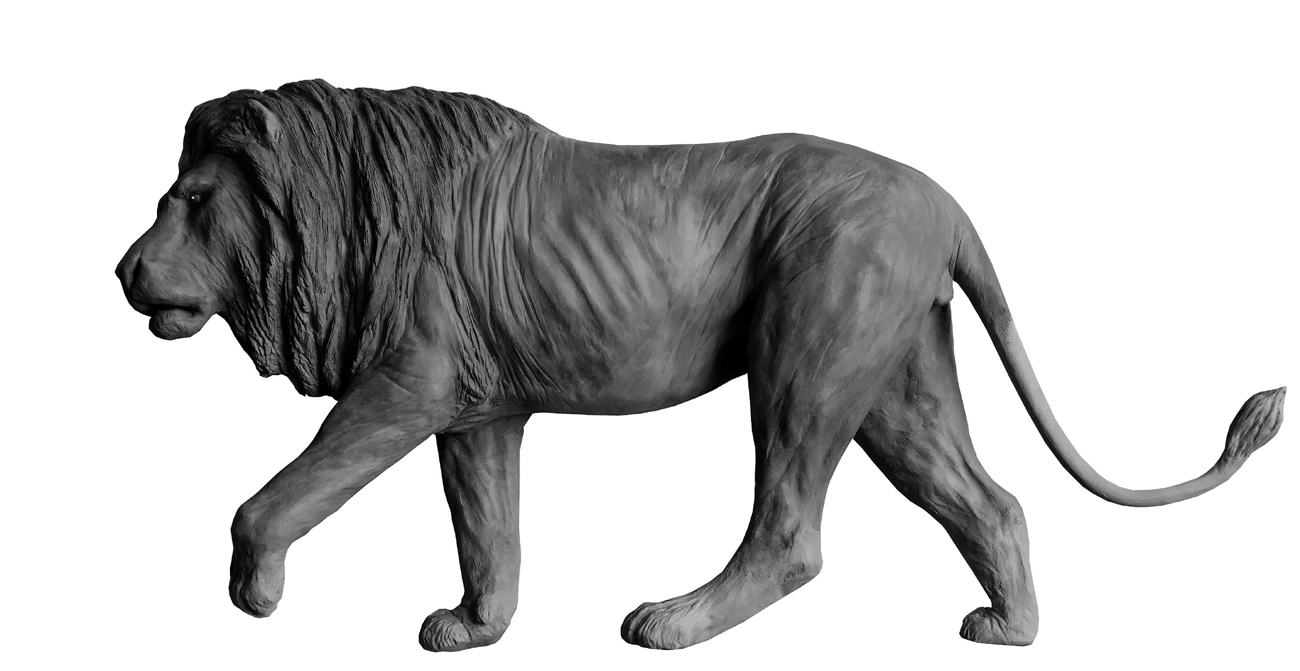
Grand lion marchant – Terre de D.Colcombet
Cela me fait un peu penser aux instructions données, au Québec, aux visiteurs des parcs hébergeant des ours. En cas de mauvaise rencontre, on leur explique ce qu’il faut faire (abandonner un sac, un vêtement, etc.), non sans les avoir prévenu que les ours courent plus vite que les hommes, nagent très bien et grimpent aux arbres (heureusement qu’ils ne volent pas !). Dernier conseil : leur jeter du poivre sur le museau, ce qui pourrait les faire fuir. C’est vraiment l’ultime recommandation…
Un deuxième passage, qui ressemble presque mot pour mot à ce que m’a dit au Burkina-Faso un guide de chasse ayant abattu la veille, à 4 mètres de lui, un lion chargeant :
« Quand il a été chassé de place en place, poussé d’un côté et de l’autre […], la disposition naturellement amène du lion tourne à l’aigreur. Tout d’abord, il se met à gronder et à rugir face à ses ennemis, afin de les terrifier et de les forcer à le laisser en paix. Finalement, quand chaque tentative de persuasion pacifique a échoué, il s’arrête brusquement et propose d’engager la bataille. Une fois qu’il en est arrivé là, il ne fuira plus. Il a l’intention de se battre et de se battre à mort. Il a l’intention de charger jusqu’au bout ; et quand un lion, rendu fou par l’agonie d’une blessure par balle, en détresse du fait d’une longue et pénible poursuite […] finit par se décider à charger, la mort devient l’unique conclusion possible. Des membres, des mâchoires brisées, un corps ravagé de part en part, des poumons transpercés, des entrailles déchirées et saillantes – rien de tout cela ne compte. Ce doit être la mort – instantanée et absolue – pour le lion, sans quoi c’est l’homme qui meurt ».

Et voici un troisième extrait, très étonnant si l’on se souvient qu’il a été écrit en 1907, en pleine fièvre colonisatrice :
« Qu’en est-il de l’Africain ? Quatre millions de ces hommes à la peau sombre vivent dans les districts du protectorat de l’Afrique de l’Est et sont soumis, entièrement ou partiellement, à son administration. Un nombre plus grand encore d’entre eux vivent au-delà de ces vastes frontières. Quel rôle vont-ils jouer dans la formation de l’avenir de leur pays ? C’est après tout leur Afrique. Que vont-ils faire pour elle et que va-t-elle faire pour eux ?
« Les indigènes, dit le planteur, manifestent une grande réticence à l’idée de travailler, et surtout de travailler régulièrement ». D’autre disent : « Il faut les forcer à travailler ». Nous demandons innocemment : « Les forcer à travailler pour qui ? » La réponse ne se fait pas attendre : « Pour nous, évidemment. Vous pensiez que nous voulions dire autre chose ? ».

Et encore :
« C’est sentir le sol trembler sous ses pieds que de comparer la vie et le lot de l’indigène africain – tranquille dans son abîme de dégradation satisfaite, riche au sens où tout lui manque et où il ne veut rien – avec le long cauchemar d’inquiétude et de privation, de saleté, de tristesse et de misère, éclairé seulement par les éclats d’une connaissance qui torture et d’un espoir qui allèche, ce cauchemar qui constitue la vie de tant de gens pauvres en Angleterre et en Ecosse.
« Cela ne serait pas bien d’avoir beaucoup de « Blancs miséreux » dans ce pays, ai-je entendu dire un jour un gentleman. « Cela détruirait le respect de l’indigène pour l’homme blanc, s’il voyait quels gens misérables nous avons chez nous ».

Voilà, les rôles sont renversés et la civilisation a honte de ses combines en présence d’un sauvage, embarrassée qu’il puisse voir ce qui se cache derrière l’or et la pourpre de la robe de l’Etat et commencer à subodorer la fraude de l’homme blanc tout-puissant. »
Et voilà donc ce qu’à 33 ans écrit Churchill, sous-secrétaire d’Etat aux Colonies, en 1907.
« Mon voyage en Afrique » – Winston Churchill – Editions Tallandier – 196 p. – 8 Euros
