Je viens de relire « Monsieur Barye » par Michel Poletti, qui est également, avec Alain Richarme, l’auteur d’un ouvrage de référence paru en 2000 : « Barye – Catalogue raisonné des sculptures » (Gallimard).
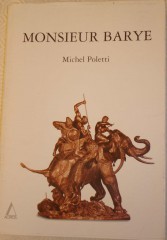
« La vie de Barye se raconte en quinze lignes » (Charles Blanc, historien et critique d’art contemporain de Barye). Heureusement que M.Poletti ne s’en contente pas et va bien au-delà, puisant dans une abondante documentation et s’appuyant notamment sur « L’oeuvre de Barye » de Roger Ballu, paru en 1890.

« Monsieur Barye » se lit comme un roman. On y découvre un enfant pauvre et sans instruction, entrant très jeune en apprentissage chez un graveur sur acier, mobilisé en 1811 comme huit autres employés mais seul survivant en 1814. Très tôt « tourmenté par sa vocation de sculpteur » selon ses propres mots, son destin a peut-être été radicalement influencé par un sculpteur faisant partie comme lui de la Garde Nationale et qui lui donna des conseils. Barye en parlait comme d’une rencontre importante.

A l’époque, la seule façon pour un artiste de se faire remarquer, de vendre, d’engranger des commandes et donc de vivre était le salon des artistes français, que l’on appelait simplement « le Salon ». Par ses origines prestigieuses – il a été créé par Colbert – et par l’abondance des œuvres présentées, il est extrêmement réputé et populaire. La presse se fait l’écho de ce qu’on y voit, ce qui s’y passe, les critiques y assassinent des artistes ou les portent aux nues, des scandales éclatent à propos de certaines œuvres comme, par exemple, « Le gorille emportant une négresse » de Frémiet (NB : « Le déjeuner sur l’herbe » de Manet fit lui aussi scandale, en 1863, mais c’était au Salon des Refusés).

A l’époque de Barye, au Salon, les peintres se taillent la part du lion alors que les sculpteurs sont relégués dans un couloir étroit et sombre. Lors du vernissage – terme né au Salon – la foule est immense et… pas toujours très soigneuse ! Balzac, dans un de ses romans, raconte que les sculptures sont « entassées les unes sur les autres dans un espace de quelques pieds carrés et si serrées que quatre personnes ne peuvent rester en même temps à les examiner« . Une chroniqueuse de l’époque évoque « le public le plus vulgaire, les femmes les plus communes, les tournures les plus grotesques. Et puis, quelle foule ! Comme on se pousse ! A chaque porte, quelle cohue ! ». Avec philosophie, Barye raconte, lui, que ce qu’il présente « placé au bas de l’escalier servait de vestiaire. Souvent, j’y trouvais accroché quelques paletots ou quelques châles. Mais, enfin, j’y étais ! ».

Barye aura de nombreux enfants (11 ! dont Alfred, très bon sculpteur lui aussi) mais hélas il en perdra beaucoup, comme sa première femme, et la quasi-misère le forcera à les déposer à la fosse commune. Car il fallut attendre bien longtemps avant que son génie, pourtant remarqué par les critiques dès ses premiers envois au Salon, lui permette d’enfin « décrocher » des commandes publiques, de récupérer ses moules, chefs-modèles et outils – jusqu’à son poinçon – gagés chez son créancier. Ce n’est qu’à près de 60 ans qu’Antoine-Louis Barye peut enfin jouir d’une certaine aisance. « J’ai attendu les chalands toute ma vie, ils m’arrivent au moment où je ferme mes volets ! » dira l’artiste avec sans doute un peu d’amertume.

M.Poletti trace ainsi le portrait d’un homme profondément humble, d’une extrême honnêteté, travailleur infatigable, mû par un élan, une force intérieure qui lui fait traverser toutes les difficiles épreuves de la vie, d’un XIXème siècle très agité, et surmonter les pièges et mauvais coups des jaloux.
Barye était aussi peintre et fit partie de l’école de Barbizon, où il acheta l’ancienne maison de l’excellent peintre Olivier de Penne. La principale source d’inspiration de sa sculpture et de sa peinture, à lui qui ne quittait pas souvent Paris et ne voyagea jamais hors de France, est toujours restée la ménagerie du Jardin des Plantes, où, très jeune, il entrait furtivement à l’aube grâce au gardien (le « père Rousseau »), qui lui offrait parfois quelques tartines soustraites aux ours.

Comme, plus tard, avec Rosa Bonheur, on pourrait presque dire que les collectionneurs et marchands américains découvrirent Barye avant les Français, précisément à partir de 1859. En 1873, Corcoran, qui venait de créer à Washington la Corcoran Gallery, décide d’y créer une salle entière dédiée à Barye. Pour la remplir, il commande à l’artiste une pièce de chacun de ses modèles. « Mon propre pays n’en a jamais fait autant pour moi ! » dira Barye, ému aux larmes.

Je n’ai cité ici que quelques épisodes de la vie de ce grand artiste mais on comprend déjà que la vie de Barye ne se résume finalement pas « à 15 lignes » mais est contraire très riche. Abondamment illustré, bien écrit, ce livre est d’un très grand intérêt. A lire.
« Monsieur Barye » – Michel Poletti – Editions Acatos – Novembre 2002 – 322 p.

